- play_arrow
Big Bang Radio Le Son De La Terre
 Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff
Les Innocents - Colore quelle est la différence entre la physique et la mécanique quantique?😢 Jeff  Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs
Massive Attack - Teardrop je voudrais offrir ce titre de Massive Attack à toute l'équipe ! Phillipe R. J'ai lu votre récit sur le "System Solaire, Le Grand Voyage" .. et j'ai encore appris des trucs
Conquête Solaire : La Sonde Parker, au plus près des secrets de notre étoile
Un Jalon pour l’Humanité : « Toucher le Soleil »
L’histoire de l’exploration humaine est jalonnée de moments où l’impossible devient réalité. Le 24 décembre 2024, l’humanité a écrit un nouveau chapitre de cette grande épopée. La sonde Parker Solar Probe de la NASA, dans un silence assourdissant, a frôlé notre étoile de si près qu’elle a, au sens propre comme au figuré, « touché le Soleil ».1 Cet exploit n’est pas simplement un record de plus dans les annales de la cosmonautique ; il représente l’aboutissement d’une ambition scientifique vieille de plus de soixante ans, une quête pour comprendre la fournaise qui nous donne la vie et qui, en même temps, menace notre monde technologique.
Cette mission porte le nom d’un pionnier, l’astrophysicien Eugene Parker. En 1958, il a postulé l’existence d’un flux constant de particules s’échappant du Soleil, un phénomène qu’il a baptisé le « vent solaire ».1 À l’époque, sa théorie fut accueillie avec un scepticisme considérable, mais elle est aujourd’hui le fondement de l’héliophysique, l’étude de notre Soleil et de son influence sur le système solaire. Dans un hommage sans précédent, la NASA a nommé cette mission en son honneur de son vivant, une première dans l’histoire de l’agence, soulignant l’importance capitale de ses travaux visionnaires.2
Au cœur de la mission Parker se trouve une dualité fondamentale. Le Soleil est le moteur de la vie sur Terre, une source d’énergie stable et bienveillante. Mais il est aussi une étoile active, sujette à des « humeurs » violentes que les scientifiques appellent la météo spatiale. Ces éruptions, ces vents de particules et ces tempêtes magnétiques constituent une menace croissante pour notre civilisation, de plus en plus dépendante de ses infrastructures orbitales et terrestres, comme les satellites de communication, les réseaux électriques et les systèmes de navigation.3 La sonde Parker est notre émissaire le plus audacieux, envoyé au plus près du danger pour comprendre, et un jour peut-être, prédire ces colères solaires.
Le succès de cette mission est le fruit d’une convergence remarquable entre l’ambition scientifique et la maturation technologique. Les questions fondamentales sur la couronne solaire et l’origine du vent solaire sont posées depuis les travaux de Parker dans les années 1950.3 Comme le confiait Nour Rawafi, responsable scientifique de la mission, en juillet 2025 : « Nous attendions ce moment depuis la fin des années 1950 ».6 Si la réponse a tant tardé, c’est que les défis étaient titanesques. Envoyer un instrument au cœur de l’atmosphère solaire signifiait affronter un environnement d’une hostilité inimaginable : des températures approchant les 1400°C et un niveau de radiation près de 500 fois supérieur à celui que nous connaissons en orbite terrestre.5 La concrétisation de ce rêve a dû attendre des décennies de progrès en science des matériaux, qui ont abouti à la création d’un bouclier thermique en composite de carbone révolutionnaire, et en systèmes autonomes capables de piloter la sonde sans contact avec la Terre lors de ses passages les plus critiques.1 Ainsi, la mission Parker ne raconte pas seulement l’histoire de ce que nous apprenons, mais aussi celle de la raison pour laquelle nous ne pouvions l’apprendre qu’aujourd’hui.
Périhélie Record ! Au Cœur de la Fournaise Solaire
Le périple de la sonde Parker a atteint un point culminant spectaculaire à la fin de l’année 2024, inaugurant une nouvelle ère dans l’étude de notre étoile. Cet événement n’était pas tant un aboutissement qu’un commencement, le début de la phase la plus critique et la plus révélatrice de la mission.
Le Jalon du 24 Décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la sonde Parker Solar Probe a pulvérisé ses propres records, réalisant l’approche la plus audacieuse du Soleil jamais tentée par un engin humain.1 Les chiffres de cet exploit, confirmés par de multiples sources, donnent le vertige :
Proximité : La sonde s’est aventurée à seulement 6,1 millions de kilomètres (environ 3,8 millions de miles) de la surface visible du Soleil, la photosphère.1 Pour mettre cette distance en perspective, elle se trouvait bien à l’intérieur de l’orbite de Mercure (qui s’approche au mieux à 46 millions de km) et plus de sept fois plus près que n’importe quel autre satellite avant elle.3 Une analogie proposée par la NASA illustre cette prouesse : si la distance Terre-Soleil représentait la longueur d’un terrain de football, la sonde se trouverait à moins de 4 mètres de la ligne de but.12
Vitesse : En plongeant dans cet espace de gravité du Soleil, Parker a atteint une vitesse stupéfiante de 692 000 km/h (environ 430 000 mph).1 Ce faisant, elle a confirmé son statut d’objet le plus rapide jamais construit par l’humanité. À cette allure, un voyage de Washington D.C. à Tokyo prendrait moins d’une minute.12
Cette manœuvre n’était pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement d’une chorégraphie orbitale méticuleusement planifiée sur six ans. La trajectoire de la sonde a été façonnée par sept assistances gravitationnelles de la planète Vénus.5 La dernière de ces rencontres, le 6 novembre 2024, a placé la sonde sur son « orbite optimale », la trajectoire finale qui lui permettrait ces passages au plus près.14 Le périhélie du 24 décembre n’était donc pas un événement isolé, mais le premier d’une série d’approches tout aussi extrêmes prévues pour 2025.14 La mission est ainsi entrée dans son « crescendo », une phase de collecte de données répétée et soutenue dans une région de l’espace jusqu’alors totalement inexplorée.
Le Signal de la Survie
Pendant les moments les plus intenses de son passage, la sonde était seule, incapable de communiquer avec la Terre, son bouclier thermique faisant face au Soleil. Au centre des opérations de la mission, au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL), l’attente était palpable. Le 26 décembre 2024, un « bip de balise » (beacon tone) a finalement été reçu.8 Ce simple signal, confirmant que la sonde avait survécu à sa traversée de la fournaise coronale et que ses systèmes fonctionnaient normalement, a déclenché un soulagement et une joie immenses. C’était le triomphe de l’ingénierie, une validation spectaculaire pour des décennies de travail qui ont rendu cette mission possible.
Premières Images, Premières Émotions
Les données scientifiques complètes ont mis plusieurs semaines à être téléchargées, mais lorsque les premières images, notamment celles de l’instrument WISPR (Wide-Field Imager for Parker Solar Probe), ont été rendues publiques en juillet 2025, elles ont dépassé toutes les attentes.1 La communauté scientifique a réagi avec un enthousiasme non dissimulé. Nour Rawafi a qualifié ces données de « mine d’or », tandis que Nicky Fox, administratrice associée à la NASA, a déclaré : « Nous sommes témoins de la naissance de menaces météorologiques spatiales pour la Terre, avec nos yeux, et pas seulement avec des modèles ».6
Pour la première fois, les scientifiques pouvaient observer des détails incroyables sur la naissance du vent solaire et la structure des éjections de masse coronale (CME), ces immenses bulles de plasma qui sont les principaux moteurs des tempêtes spatiales. Les images ont révélé des CME « empilées les unes sur les autres », une dynamique complexe jamais observée auparavant.6 Ces données ne sont pas seulement spectaculaires ; elles sont révolutionnaires et promettent d’améliorer considérablement notre capacité à prévoir la météo spatiale et à protéger nos technologies.7
| Mission | Date du Record | Distance Minimale du Soleil (millions de km) | Vitesse Maximale (km/h) |
| Parker Solar Probe | Décembre 2024 | 6,1 | ~692 000 |
| Parker Solar Probe | Septembre 2024 | 7,26 | ~635 000 |
| Helios 2 | Avril 1976 | 43,4 | ~247 000 |
| Solar Orbiter | Mars 2022 | 43,4 | N/A |
| Référence : Mercure | Périhélie | ~46 | ~170 000 |
La Quête Fondamentale – Résoudre les Grandes Énigmes Solaires
Au-delà de l’exploit technologique, la mission Parker Solar Probe est avant tout une quête scientifique. Elle a été conçue pour répondre à trois questions fondamentales qui intriguent les physiciens solaires depuis plus d’un demi-siècle. Ces objectifs, bien que distincts, sont les facettes d’un seul et même puzzle : comprendre comment l’énergie est générée, transférée et libérée par notre étoile.3
3.1 Tracer le Flux d’Énergie – Le Paradoxe de la température Coronale
Le premier grand mystère est un paradoxe thermique. La surface visible du Soleil, la photosphère, affiche une température d’environ 6 000°C. Pourtant, son atmosphère externe, la couronne, est des centaines de fois plus chaude, avec des températures qui dépassent le million de degrés Celsius.1 C’est comme si l’air autour d’un feu de camp était plus chaud que les flammes elles-mêmes, un phénomène qui semble défier les lois fondamentales de la physique. Les scientifiques supposent qu’un mécanisme inconnu pompe de l’énergie vers le haut pour surchauffer la couronne.
La méthode de Parker pour résoudre cette énigme est radicale : au lieu d’observer de loin, la sonde plonge directement dans la couronne.2 En traversant cette région, ses instruments mesurent in situ les champs magnétiques, les ondes de plasma et le flux de particules. L’objectif est de capturer sur le vif le processus de transfert d’énergie, qu’il s’agisse de micro-explosions (nanoflares), de dissipation d’ondes magnétiques ou d’autres phénomènes, afin d’identifier enfin le « moteur » responsable de cette chaleur coronal.3
3.2 Déterminer la Structure et la Dynamique des Sources du Vent Solaire
Le deuxième objectif concerne l’origine du vent solaire. Ce flux incessant de plasma (un gaz de particules chargées, principalement de protons et d’électrons) s’échappe du Soleil et balaye tout le système solaire, créant une bulle protectrice appelée l’héliosphère.15 Nous vivons littéralement à l’intérieur de l’atmosphère étendue du Soleil. Les scientifiques distinguent deux types de vent : un vent « lent », dense, et un vent « rapide », plus ténu.23 Si nous connaissons bien ses propriétés près de la Terre, son origine exacte et le mécanisme de son accélération initiale restent flous.
La clé, une fois de plus, est la proximité. Parker est la première mission à atteindre la région où le vent solaire passe d’une vitesse subsonique à supersonique.3 En échantillonnant le plasma et les champs magnétiques à leur source, la sonde peut établir un lien direct entre les structures observées à la surface du Soleil (comme les trous coronaux ou les « entonnoirs » magnétiques) et les caractéristiques du vent qui atteindra plus tard les planètes. C’est comme passer de l’étude de l’embouchure d’un fleuve à l’exploration de ses sources dans les montagnes.4
3.3 Explorer les Mécanismes d’Accélération et de Transport des Particules Énergétiques
Le troisième objectif est le plus directement lié à la sécurité de notre civilisation. Le Soleil n’émet pas seulement un vent régulier ; il produit aussi des événements explosifs, comme les éruptions solaires et les éjections de masse coronale (CME), qui projettent des particules à des vitesses proches de celle de la lumière.5 Ces particules énergétiques sont les principaux coupables des pannes de satellites, des surcharges des réseaux électriques et des risques de radiation pour les astronautes.2
La mission de Parker est de traverser les « zones d’accélération » de ces particules pour comprendre les processus physiques qui leur confèrent une énergie si colossale. En mesurant les champs électriques et magnétiques et les ondes de plasma au moment même où l’accélération se produit, les scientifiques espèrent percer les secrets de ces tempêtes solaires. Cette connaissance est indispensable pour passer de la simple observation à une véritable prévision de la météo spatiale.3
Ces trois objectifs ne sont pas des enquêtes indépendantes, mais les pièces d’un système énergétique unique et intégré. La véritable force de la mission Parker réside dans sa capacité à observer simultanément ces processus interconnectés. Le champ magnétique solaire fournit l’architecture fondamentale, les « canalisations » ou « entonnoirs » magnétiques qui structurent la couronne.23 C’est le long de ces structures que le flux d’énergie se propage, chauffant la couronne et donnant naissance au vent solaire. Enfin, les événements les plus extrêmes de ce transfert d’énergie provoquent l’accélération des particules énergétiques le long de ces mêmes autoroutes magnétiques. En cartographiant ce système dans son ensemble, des « tuyaux » magnétiques au « flux » énergétique qu’ils contiennent et aux « éclatements » dangereux qu’ils peuvent produire, Parker offre une vision holistique qui révolutionne notre compréhension de la physique solaire.
Une Merveille d’Ingénierie – La Technologie de l’Impossible
Pour s’aventurer là où aucune machine n’était jamais allée, la sonde Parker Solar Probe a dû être dotée de technologies de pointe, repoussant les limites de l’ingénierie spatiale. Sa conception est une symphonie de solutions innovantes pour survivre à l’environnement le plus hostile de notre système solaire.
4.1 Le Bouclier Thermique : Gardien de la Mission
La pièce maîtresse de la sonde est son bouclier thermique, le Thermal Protection System (TPS). Il s’agit d’un disque de 2,4 mètres de diamètre et de 11,43 cm (4,5 pouces) d’épaisseur, fabriqué à partir d’un composite de carbone-carbone pris en sandwich autour d’une âme en mousse de carbone.1 Lors de ses approches au plus près, la face avant de ce bouclier est exposée à des températures avoisinant les 1400°C.8
Il est crucial de comprendre la différence entre température et chaleur. La couronne solaire a une température de plusieurs millions de degrés, mais sa densité est extrêmement faible, c’est un quasi vide. Par conséquent, la quantité de chaleur transférée à la sonde est bien moindre que ce que la température seule pourrait suggérer. Le bouclier est principalement conçu pour réfléchir et dissiper le flux intense de photons (la lumière du Soleil).8 Grâce à cette protection, les instruments et les systèmes situés à l’ombre du bouclier fonctionnent à une température ambiante confortable d’environ 29°C (85°F), un exploit d’isolation thermique.3
4.2 L’Orbite Parfaite : La Danse Gravitationnelle avec Vénus
Atteindre une orbite si proche du Soleil est un défi de mécanique céleste. Paradoxalement, il ne s’agit pas d’accélérer, mais de freiner. Un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre possède une vitesse orbitale considérable qui l’empêche de « tomber » vers le Soleil. Pour s’approcher de notre étoile, Parker a dû perdre une grande partie de cette énergie orbitale. La solution a été une série de sept assistances gravitationnelles de la planète Vénus, étalées sur près de sept ans.5
À chaque survol de Vénus, la sonde a utilisé la gravité de la planète non pas pour gagner de la vitesse, comme c’est souvent le cas dans l’exploration spatiale, mais pour la freiner par rapport au Soleil. Ce « freinage » gravitationnel a permis de réduire progressivement la taille de son orbite elliptique, la faisant plonger de plus en plus profondément dans l’atmosphère solaire à chaque passage.3
4.3 Les Instruments et les Capteurs de la Sonde
À l’abri du bouclier se trouve une suite de quatre ensembles d’instruments scientifiques, les capteurs de la sonde qui effectuent des mesures révolutionnaires.15
FIELDS : Cet instrument mesure les champs électriques et magnétiques avec une précision extrême. Ses antennes s’étendent au-delà du bouclier pour sonder directement l’environnement électromagnétique de la couronne.21 Le capteur SCM (Search-Coil Magnetometer), contribution française majeure à la mission, fait partie de cette suite.15
SWEAP (Solar Wind Electrons Alphas and Protons) : Cette suite d’instruments collecte et analyse les particules du vent solaire. Elle comprend la « Solar Probe Cup », une coupe de Faraday qui s’étend courageusement au-delà du bouclier pour « goûter » directement le plasma solaire et mesurer sa vitesse, sa densité et sa température.2
IS☉IS (Integrated Science Investigation of the Sun) : Cet instrument est conçu pour détecter les particules les plus énergétiques : les électrons, les protons et les ions lourds qui ont été accélérés à des vitesses proches de celle de la lumière par les éruptions solaires.2
WISPR (Wide-Field Imager for Solar Probe) : Ce sont les seuls yeux de la sonde. Il s’agit d’une paire de télescopes qui prennent des images de la couronne et du vent solaire en lumière visible. En observant les structures de plasma qui s’éloignent du Soleil, WISPR fournit un contexte visuel crucial aux mesures in situ des autres instruments, permettant de reconstruire une vue en 3D des phénomènes solaires.17
La mission bénéficie d’une importante collaboration internationale, notamment française. Des laboratoires soutenus par le CNES (comme le LPC2E, le LESIA, l’IRAP) ont contribué de manière significative aux instruments, faisant de cette aventure américaine un succès mondial.15
Premières Révélations – Ce que Parker Nous a Déjà Appris
Bien que sa phase scientifique la plus intense n’ait commencé que fin 2024, la sonde Parker Solar Probe a déjà livré des découvertes qui ont forcé les scientifiques à réécrire des chapitres entiers de la physique solaire. Ses premières orbites ont fourni un aperçu alléchant des mystères qu’elle est censée résoudre.
La Découverte des « Switchbacks »
L’une des découvertes les plus surprenantes et les plus significatives de la mission concerne des structures magnétiques énigmatiques appelées « switchbacks » (ou « lacets » en français). Il s’agit d’inversions soudaines et spectaculaires de la direction du champ magnétique du vent solaire, qui prennent la forme d’un « S » ou d’un « Z ».11 Ces structures avaient été observées par des missions précédentes plus éloignées du Soleil, mais Parker a révélé qu’elles étaient beaucoup plus fréquentes et plus chaotiques près de leur source.
Remonter à la Source
Le véritable tour de force de Parker a été de se rapprocher suffisamment pour identifier l’origine de ces switchbacks. En 2021, alors qu’elle se trouvait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil, la sonde a pu établir une connexion directe entre ces inversions magnétiques et des structures spécifiques à la surface du Soleil. Les données ont montré que les switchbacks naissent au niveau d’ « entonnoirs » magnétiques situés dans la photosphère, là où les lignes de champ magnétique s’ouvrent et se ferment.23 Cette découverte a résolu un puzzle vieux de plusieurs décennies en fournissant la première preuve directe d’un mécanisme qui contribue à alimenter et à structurer le vent solaire rapide. C’est un lien de cause à effet qui n’aurait jamais pu être établi sans être sur place.
Une Couronne Complexe et Dynamique
Les observations de Parker ont également révélé que la couronne solaire est bien plus complexe et dynamique qu’on ne le pensait. La frontière entre l’atmosphère solaire et le vent solaire interplanétaire, connue sous le nom de surface d’Alfvén, n’est pas une sphère lisse et uniforme. Au contraire, elle est très inégale, pleine de pics et de vallées, ce qui signifie que la sonde peut la traverser plusieurs fois au cours d’un même passage.11 Cette topographie complexe a des implications profondes sur la manière dont l’énergie et les particules s’échappent du Soleil.
Ces découvertes, bien qu’apparemment ésotériques, ont des implications très concrètes. Comprendre la structure fine du vent solaire à sa source est une étape essentielle pour améliorer la précision des modèles de météo spatiale. En identifiant les mécanismes qui façonnent le vent solaire, les scientifiques peuvent mieux prédire comment une tempête née sur le Soleil se propagera à travers le système solaire et quel sera son impact lorsqu’elle atteindra la Terre.6 Parker ne fait pas que satisfaire notre curiosité ; elle construit les fondations d’un système d’alerte précoce pour protéger notre avenir.
L’Avenir de la Mission et son Héritage Immortel
La phase la plus exaltante de la mission Parker Solar Probe est en cours. Après le succès retentissant de son passage record de décembre 2024, la sonde est programmée pour continuer à défier les limites de l’exploration, assurant un héritage scientifique qui perdurera bien au-delà de sa propre existence.
Le Grand Final
Le périhélie du 24 décembre 2024 n’était que le premier d’une série de passages à une distance minimale de 6,1 millions de kilomètres. Après celles du 22 mars et du 19 juin 2025, la mission primaire prévoit une autre rencontre à cette distance record formant le « grand final » de sa quête scientifique, le 15 septembre 2025 17
Chacun de ces passages offrent une nouvelle occasion de recueillir des données d’une qualité sans précédent dans la région la plus mystérieuse de la couronne solaire. La répétition de ces mesures est cruciale pour distinguer les phénomènes constants des événements passagers et pour construire une image statistique robuste de l’environnement solaire.
Un Héritage pour la Science
L’héritage de Parker Solar Probe est déjà immense. Elle fournit non seulement des réponses à des questions vieilles de 60 ans, mais elle génère aussi de nouvelles interrogations qui stimuleront la recherche pour les décennies à venir.4 Les données recueillies constituent un trésor qui sera exploité par une génération entière de physiciens et d’étudiants.
De plus, en nous offrant une compréhension intime de notre propre étoile, la mission jette une lumière nouvelle sur le fonctionnement de milliards d’autres étoiles dans l’univers.5 Les processus de chaleur coronale et d’accélération des vents stellaires sont universels, et les découvertes de Parker serviront de pierre de Rosette pour déchiffrer les observations d’étoiles lointaines.
La Fin Poétique
La mission conçue pour une durée de vie nominale de sept ans, se terminant cette année en 2025. Cependant, les ingénieurs ont constaté que la sonde disposait de plus de carburant que prévu, ce qui pourrait lui permettre de continuer à fonctionner pendant plusieurs années, voire décennies, jusqu’à ce que ses panneaux solaires et ses systèmes se dégradent sous l’effet des radiations intenses.6
Lorsque sa mission s’achèvera enfin, la sonde ne sera pas abandonnée à une dérive sans fin. Son orbite la condamne à rester captive du Soleil. Au fil du temps, elle se désintégrera lentement sous l’effet de l’environnement extrême. Dans une fin d’une poésie saisissante, Nour Rawafi prédit que la sonde deviendra finalement « une partie du vent solaire lui-même ».6 L’explorateur se fondra dans l’objet même de son exploration, un ultime hommage à sa quête audacieuse.
| Date | Événement | Importance |
| 12 août 2018 | Lancement (fusée Delta IV Heavy) | Début de la mission de sept ans.12 |
| 3 octobre 2018 | 1er survol de Vénus | Première des sept manœuvres de réduction d’orbite.12 |
| 21 août 2023 | 6ème survol de Vénus | Avant-dernière assistance gravitationnelle.5 |
| 6 novembre 2024 | 7ème et dernier survol de Vénus | Finalisation de la trajectoire, mise en place de l’orbite optimale.5 |
| 24 décembre 2024 | 1er périhélie record (6,1 M km) | Début de la phase scientifique finale, « toucher le Soleil ».8 |
| 22 mars 2025 | 2ème périhélie record | Collecte de données répétée dans la couronne interne.14 |
| 19 juin 2025 | 3ème périhélie record | Fin de la mission primaire nominale.5 |
| 15 septembre 2025 | 4ème périhélie record | Continuation de l’observation à distance minimale.17 |
Conclusion
La sonde Parker Solar Probe est bien plus qu’un simple satellite. Elle est l’incarnation de la curiosité humaine, un testament de notre ingéniosité collective et le prolongement de nos sens dans l’un des environnements les plus extrêmes que nous puissions imaginer. En « touchant le Soleil », elle n’a pas seulement battu des records de vitesse et de proximité ; elle a ouvert une fenêtre sur les mécanismes fondamentaux qui régissent notre étoile et, par extension, notre existence même.
Les données qu’elle a recueillies et qu’elle continue de transmettre sont en train de transformer notre compréhension de la physique solaire. Les réponses qu’elle apporte au paradoxe de la température coronale, à l’origine du vent solaire et à l’accélération des particules énergétiques ne sont pas de simples curiosités académiques. Elles constituent la base scientifique sur laquelle nous pourrons construire des systèmes de prévision de la météo spatiale plus fiables, protégeant ainsi notre société de plus en plus vulnérable aux colères du Soleil.
De l’audace théorique d’Eugene Parker à la persévérance des milliers d’ingénieurs et de scientifiques qui ont consacré des années de leur vie à ce projet, la mission Parker Solar Probe est une réussite éclatante. Alors qu’elle poursuit sa danse solitaire et ardente autour du Soleil, elle nous rappelle que les limites de l’exploration ne sont définies que par l’étendue de notre imagination et notre volonté de savoir. Son héritage, gravé dans les données qu’elle nous lègue, illuminera notre connaissance de l’univers pour des générations à venir.
Écrit par: La rédaction
Articles similaires
Rechercher
Big Bang Radio
ça vient de passer sur Big Bang Radio
Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...Articles Récents

Parker Solar dans la Proche Banlieue du Soleil

Naissance Et Mort d’Un Trou Noir
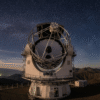
Les Yeux de la Terre, une Histoire de Télescopes

GW190521 – Gigantesque Fusion de deux « Super Massive Black Hole »
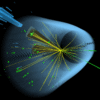
Le Boson de Higgs : Une Clé de l’Univers ?
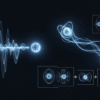
Les Sept Piliers de l’Univers Quantique

Le Soleil – Portrait Intime de Notre Étoile


